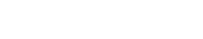Atelier méthodologique Complet
Bonaventure
2 décembre 2025
Contexte
L’épidémiologie spatiale permet de décrire les patrons spatiaux, d’identifier des agrégats et d’expliquer ou de prédire le risque de maladie. Elle combine les méthodes de l’épidémiologie, de la statistique et des Systèmes d’Information Géographique (SIG). Cette branche de l’épidémiologie est devenue incontournable en santé publique pour la gestion des risques pour la santé. L’utilisation d’outils tels que les SIG et les méthodes statistiques spatiales, nécessitent toutefois un certain niveau d’appropriation par les différent(e)s acteur(-trice)s de santé publique pour les utiliser à leur plein potentiel.
L’épidémiologie spatiale est utilisée dans les trois domaines de protection de la santé (maladies infectieuses, santé au travail et santé environnementale et toxicologie) incluant la santé animale dans le cadre du paradigme Une seule santé, favorisant ainsi la collaboration multidisciplinaire en santé.
Cette journée permettra aux participantes et participants d’appliquer les concepts et d’utiliser les résultats d’analyses de l’épidémiologie spatiale pour soutenir les interventions de protection en santé publique.
Cette formation s’adresse aux intervenants et intervenantes, aux médecins, au personnel professionnel œuvrant en protection de la santé, à la communauté étudiante en santé publique ou en épidémiologie, aux partenaires des municipalités et aux autres ministères.
Objectifs pédagogiques
À la fin de cette activité, les personnes participantes seront en mesure de :
- Décrire les concepts en épidémiologie spatiale et les méthodes d’analyse courantes et leurs limites
- Interpréter les résultats d’analyses spatiales dans le contexte de la vigie et des enquêtes de santé publique
- Illustrer les contextes dans lesquels l’épidémiologie spatiale permet de soutenir les interventions de protection en santé publique
Méthode pédagogique
L’atelier comprend des présentations d’expert(e)s sur le sujet et des discussions en groupe autour de mises en situation inspirées de la réalité. Toutes les mises en situation s’effectuent en sous-groupes. Les apprenantes et les apprenants participeront à une étude de situation d’éclosion dans laquelle ils (elles) joueront le rôle d’intervenant(e)s en santé publique appelé(e)s à utiliser des résultats d’analyse spatiales en complémentarité avec des données épidémiologiques.
Une place privilégiée sera accordée aux échanges entre les participant(e)s. Des animateurs et animatrices seront chargé(e)s de maintenir ces interactions.
8 h 30 à 9 h 30
Conférence plénière
9 h 30 à 10 h
Pause – Visite des présentations par affiches et du salon d'exposition
Horaire de l’avant-midi
Animation de l’avant-midi
Mireille Barakat, M. Sc., conseillère scientifique, Direction des risques biologiques, Institut national de santé publique du Québec
Lauriane Padet, Ph. D., conseillère scientifique spécialisée, Direction des risques biologiques, Institut national de santé publique du Québec
10 h à 10 h 20
Activité brise-glace
Cette activité inclut une période d’interactivité de 10 minutes.
L’activité permet de répondre à l’objectif suivant : Appliquer les concepts et d’utiliser les résultats d’analyses de l’épidémiologie spatiale pour soutenir les interventions de protection en santé publique.
10 h 20 à 11 h 10
Concepts de base en épidémiologie spatiale
Nathalie Gravel, M. Sc., coordonnatrice de l’équipe géomatique, Bureau d’information et d’études en santé des populations, Institut national de santé publique du Québec
Cette activité inclut une période d’interactivité de 10 minutes.
L’activité permet de répondre à l’objectif suivant : Décrire les concepts en épidémiologie spatiale et les méthodes d’analyse courantes et leurs limites.
11 h 10 à 12 h
Mise en situation no 1 – Initiation à la cartographie dans le contexte de la vigie et des enquêtes de santé publique
Cette activité inclut une période d’interactivité de 50 minutes.
L’activité permet de répondre à l’objectif suivant : Interpréter des résultats d’analyses spatiales dans le contexte de la vigie et des enquêtes de santé publique
12 h à 13 h 45
Dîner – Visite des présentations par affiches et du salon d'exposition
Horaire de l’après-midi
Animation de l’après-midi
Félix Lamothe, M. Sc., conseiller scientifique, Direction de la santé environnementale, au travail et de la toxicologie, Institut national de santé publique du Québec
Noémie Savard, M.D., M. Sc., F.R.C.P.C., médecin-spécialiste, Direction des risques biologiques, Institut national de santé publique du Québec
13 h 45 à 14 h
Synthèse de l’avant-midi et activité interactive avec l’auditoire
Cette activité inclut une période d’interactivité de 15 minutes.
L’activité permet de répondre à l’objectif suivant : Appliquer les concepts et d’utiliser les résultats d’analyses de l’épidémiologie spatiale pour soutenir les interventions de protection en santé publique
14 h à 14 h 25
Exemples d’application de l’épidémiologie spatiale en contexte d’urgence environnementale
Tudor Matei, M. Sc., agent de planification, de programmation et de recherche, Toxicologue, Secteur Environnements urbains et santé des populations, Direction de santé publique, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Cette activité inclut une période d’interactivité de 5 minutes.
L’activité permet de répondre à l’objectif suivant : Illustrer les contextes dans lesquels l’épidémiologie spatiale permet de soutenir les interventions de protection en santé publique.
14 h 25 à 14 h 50
Détection statistique d'agrégats spatiaux
Julie Arsenault, D.M.V., Ph. D., professeur titulaire, Faculté de médecine vétérinaire, Département de pathologie et microbiologie, Université de Montréal
Cette activité inclut une période d’interactivité de 5 minutes.
L’activité permet de répondre à l’objectif suivant : Décrire les concepts en épidémiologie spatiale et les méthodes d’analyse courantes et leurs limites.
14 h 50 à 15 h 15
Mise en situation no 2 (Partie 1) – Interprétation des résultats d'analyses statistiques
Cette activité inclut une période d’interactivité de 25 minutes.
L’activité permet de répondre à l’objectif suivant : Interpréter des résultats d’analyses spatiales dans le contexte de la vigie et des enquêtes de santé publique.
15 h 15 à 15 h 30
Courte pause
15 h 30 à 15 h 55
Mise en situation no 2 (Partie 2) – Interprétation des résultats d'analyses statistiques
Cette activité inclut une période d’interactivité de 25 minutes.
L’activité permet de répondre à l’objectif suivant : Interpréter des analyses spatiales dans le contexte de la vigie et des enquêtes de santé publique.
15 h 55 à 16 h 55
Mise en situation no 3 – L'épidémiologie spatiale pour soutenir les interventions de protection en santé publique
Cette activité inclut une période d’interactivité de 60 minutes.
L’activité permet de répondre à l’objectif suivant : Illustrer les contextes dans lesquels l’épidémiologie spatiale permet de soutenir les interventions de protection en santé publique.
16 h 55 à 17 h 05
Synthèse et conclusion
Mireille Barakat, M. Sc., conseillère scientifique, Direction des risques biologiques, Institut national de santé publique du Québec
Lauriane Padet, Ph. D., conseillère scientifique spécialisée, Direction des risques biologiques, Institut national de santé publique du Québec
Cette activité inclut une période d’interactivité de 10 minutes.
L’activité permet de répondre à l’objectif suivant : Appliquer les concepts et d’utiliser les résultats d’analyses de l’épidémiologie spatiale pour soutenir les interventions de protection en santé publique
Comité scientifique
Responsables
Mireille Barakat, M. Sc., conseillère scientifique, Direction des risques biologiques, Institut national de santé publique du Québec
Lauriane Padet, Ph. D., conseillère scientifique spécialisée, Direction des risques biologiques, Institut national de santé publique du Québec
Membres
Marie-Claude Boivin, M. Sc., conseillère scientifique, Bureau d’information et d’études en santé des populations, Institut national de santé publique du Québec
Patricia Cunningham, B. Sc. Inf., infirmière, Direction de santé publique, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Colette Gaulin, M.D., médecin-conseil, Direction de la vigie sanitaire et des maladies infectieuses, ministère de la Santé et des Services sociaux
Slim Haddad, M.D., Ph. D., médecin spécialiste, Direction de santé publique, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
Caroline Huot, M.D., M. Sc., F.R.C.P.C., médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, Direction de la santé environnementale, au travail et de la toxicologie, Institut national de santé publique du Québec
Erin Rees, Ph. D., M. Sc., B. Sc., Biologiste de recherche, cheffe de l’unité de géomatique de la santé publique, Agence de la santé publique du Canada
Collaboratrices et collaborateurs
Juliana Ayres Hutter, M. Sc., M.P.H., conseillère scientifique, Direction des risques biologiques, Institut national de santé publique du Québec
Julia Heron, M. Sc., médecin-résidente R5 en santé publique et médecine préventive, Université McGill
Félix Lamothe, M. Sc., conseiller scientifique, Coordonnateur - Surveillance et vigie en santé environnementale, Direction de la santé environnementale, au travail et de la toxicologie, Institut national de santé publique du Québec
Noémie Savard, M.D., M. Sc., F.R.C.P.C., médecin-spécialiste, Direction des risques biologiques, Institut national de santé publique du Québec