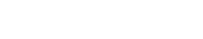Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un trouble neurodéveloppemental touchant un grand nombre d'enfants et de jeunes adultes. D’avril 2000 à mars 2023, sa prévalence annuelle est passée de 0,8 % à 4,2 % chez les personnes de 1 à 24 ans selon le Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ). Cette hausse est largement attribuée à une meilleure reconnaissance du trouble, ainsi qu'à une sensibilisation et à une éducation accrue de la population concernant le TDAH.
Bien qu'il existe des traitements pour atténuer les symptômes du TDAH, l'augmentation de l'utilisation de la médication, surtout au Québec, soulève des préoccupations. De plus, les effets de la pandémie de COVID-19 sur la population québécoise ayant le TDAH sont encore peu documentés, et les parents d'enfants atteints de ce trouble font face à une certaine stigmatisation. Dans cette demi-journée, nous examinerons la tendance du TDAH, en incluant de nouvelles données sur l’utilisation des services et la médication, et nous proposerons des explications pour cette augmentation au Québec et dans ses régions. Nous aborderons également l'importance des approches collaboratives dans la réalisation de portraits de surveillance du TDAH, en mettant l’accent sur la collaboration entre les équipes de santé publique, des cliniques, de la recherche et les partenaires externes.
Cette demi-journée permettra aux participantes et aux participants de situer les nouvelles connaissances sur la surveillance du TDAH dans leurs pratiques professionnelles.
La formation s’adresse aux personnes travaillant en surveillance, intervenant dans le milieu communautaire ou clinique, aux décisionnaires, au personnel de la recherche, à la communauté étudiante et aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux.
À la fin de cette activité, les personnes participantes seront en mesure de :
- Décrire les tendances temporelles de la prévalence du TDAH, de l'utilisation des services et de l'usage des médicaments en lien avec le TDAH, ainsi que l'impact de la COVID-19 sur ces tendances
- Échanger sur les pratiques collaboratives entre la santé publique, les directions cliniques, les chercheur(e)s et les partenaires externes pour la surveillance du TDAH
8 h 30 à 9 h 30
Conférence plénière
9 h 30 à 10 h
Pause santé et visite du Salon d’exposition
HORAIRE DE L’AVANT-MIDI
Animation de l’avant-midi
Alain Lesage, M.D., psychiatre et chercheur, Institut universitaire en santé mentale de Montréal; Université de Montréal
10 h à 10 h 15
Mot de bienvenue
10 h 15 à 10 h 30
Activité brise-glace
Frédéric Boisrond, MBA, sociologue, Regroupement des Associations PANDA du Québec
Les conférencières et les conférenciers prépareront deux ou trois questions ouvertes destinées aux personnes participantes, portant sur les sujets qui seront abordés lors de cette demi-journée thématique. Ces questions seront directement liées à l'importance de la fonction de surveillance pour sensibiliser et promouvoir des décisions politiques favorables à la santé. Il n'y aura pas de bonnes ou de mauvaises réponses; l'objectif sera de recueillir vos points de vue sur les sujets chauds liés au TDAH. Ces échanges pourraient éventuellement nourrir nos réflexions et enrichir la surveillance de ce trouble.
L’activité inclut une période d’interactivité de 15 minutes.
Cette activité permet de répondre à l’objectif suivant : Échanger sur les pratiques collaboratives entre la santé publique, les directions cliniques, les chercheur(e)s et les partenaires externes pour la surveillance du TDAH.
10 h 30 à 11 h 25
Conférences
Les conférences seront d’une durée de 10 minutes. A la fin de celles-ci, les personnes participantes pourront intervenir et discuter avec les conférencières et les conférenciers.
Portrait du TDAH et utilisation de services chez les 1 à 24 ans au Québec
Martin Gignac, M.D., psychiatre pour enfants et adolescents, Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel; professeur agrégé de clinique, Université de Montréal
Appuyés par des données médico-administratives, les sujets tels que la prévalence, l'incidence, les déterminants socioéconomiques, les maladies concomitantes, la prescription de médicaments et l'utilisation des services par les personnes ayant le TDAH seront abordés.
Cette activité permet de répondre à l’objectif suivant : Décrire les tendances temporelles de la prévalence du TDAH, de l’utilisation des services et de l’usage des médicaments en lien avec le TDAH, ainsi que l’impact de la COVID-19 sur ces tendances.
Impact de l’usage des médicaments pour le TDAH
Helen-Maria Vasiliadis, Ph. D., M. Sc., professeure agrégée et chercheure, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke
Nous examinerons l'impact de la prescription de médicaments pour le TDAH sur les blessures, les traumatismes et la mortalité, en comparant les personnes utilisatrices aux non-utilisatrices de ces médicaments.
Cette activité permet de répondre à l’objectif suivant : Décrire les tendances temporelles de la prévalence du TDAH, de l’utilisation des services et de l’usage des médicaments en lien avec le TDAH, ainsi que l’impact de la COVID-19 sur ces tendances.
Répercussions de la COVID-19 sur le TDAH
Alain Lesage, M.D., psychiatre et chercheur, Institut universitaire en santé mentale de Montréal; Université de Montréal
La conférence traitera de la prévalence du TDAH entre la période pandémique et la période pré-pandémique, en prenant en compte différents indicateurs tels que le sexe, l'âge, les régions sociosanitaires et l'utilisation des services de santé parmi les personnes ayant le TDAH ou une prescription pour ce trouble.
Cette activité permet de répondre à l’objectif suivant : Décrire les tendances temporelles de la prévalence du TDAH, de l’utilisation des services et de l’usage des médicaments en lien avec le TDAH, ainsi que l’impact de la COVID-19 sur ces tendances.
Stigmatisation et TDAH
Frédéric Boisrond, MBA, sociologue, Regroupement des Associations PANDA du Québec
L’évolution de la stigmatisation des parents d’enfants ayant le TDAH au Québec, qu’ils optent ou non pour un traitement médicamenteux, est le sujet de cette présentation. La discussion sera enrichie par les expériences partagées et les perspectives variées des personnes participantes, dans le but de sensibiliser collectivement sur le sujet du TDAH.
Cette activité permet de répondre à l’objectif suivant : Décrire les tendances temporelles de la prévalence du TDAH, de l’utilisation des services et de l’usage des médicaments en lien avec le TDAH, ainsi que l’impact de la COVID-19 sur ces tendances.
L’activité inclut une période d’interactivité de 15 minutes.
11 h 25 à 11 h 55
Table ronde
Pratique collaborative dans la surveillance du TDAH en santé publique
Panélistes
Alain Lesage, M.D., psychiatre et chercheur, Institut universitaire en santé mentale de Montréal; Université de Montréal.
Frédéric Boisrond, MBA, sociologue, Regroupement des Associations PANDA du Québec.
Helen-Maria Vasiliadis, Ph. D., M. Sc., professeure agrégée et chercheure, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke
Martin Gignac, M.D., psychiatre pour enfants et adolescents, Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel; professeur agrégé de clinique, Université de Montréal
Cette période sera essentiellement consacrée à la perspective de la santé publique en lien avec le TDAH, mettant en lumière l'importance de la collaboration entre le personnel clinique, les équipes de santé publique et les parents. Chaque panéliste présentera son point de vue sur divers sujets tels que le rôle des parents en tant que partenaires en santé publique, la recherche, la surveillance et la représentation citoyenne dans le contexte du TDAH.
Ensuite, une discussion collective portera sur les améliorations potentielles du rôle de la santé publique dans la surveillance de ce trouble. Cette phase sera très interactive, faisant appel à des suggestions et à des commentaires. Nous aborderons, entre autres, les défis liés à la réussite éducative et à l'impact du TDAH sur les services à l'enfance, en mettant en évidence les implications sociales et publiques. L’objectif principal de cette session sera d'améliorer la compréhension du TDAH sous l’angle de l'intervention en santé publique.
Enfin, nous discuterons également des préoccupations croissantes concernant l'augmentation des diagnostics de TDAH, en mettant en lumière les défis d'interprétation en matière de surveillance.
Cette activité inclut une période d’interactivité de 30 minutes.
Cette activité permet de répondre à l’objectif suivant : Échanger sur les pratiques collaboratives entre la santé publique, les directions cliniques, les chercheur(e)s et les partenaires externes pour la surveillance du TDAH.
11 h 55 à 12 h
Conclusion et messages clés
Alain Lesage, M.D., psychiatre et chercheur, Institut universitaire en santé mentale de Montréal; Université de Montréal
Cette activité permet de répondre à l’objectif suivant : Situer les nouvelles connaissances sur la surveillance du TDAH dans leurs pratiques professionnelles.
Comité scientifique
Responsables
Fatoumata Binta Diallo, Ph. D., conseillère scientifique spécialisée, Institut national de santé publique du Québec
Victoria Massamba, M. Sc., conseillère scientifique, Institut national de santé publique du Québec
Membres
Samuele Cortese, M.D., Ph. D., psychiatre et chercheur, University of Southampton; professeur de recherche, National Institute for Health and Care Research
Ali El-Samra, M. Sc. erg., conseiller en surveillance de l’état de santé, Direction générale de santé publique, Direction de la surveillance de l’état de santé, ministère de la Santé et des Services sociaux
Alvine Fansi, Ph. D., gestionnaire, Direction des services professionnels, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l ‘Île-de-Montréal
Carlotta Lunghi, Ph. D., chercheure, Département de Sciences Médicales et Chirurgicales, Université de Bologne
Manon Noiseux, M. Sc., actrice de surveillance, Direction de santé publique, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre
Elham Rahme, Ph. D., chercheure, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université McGill
Louis Rochette, M. Sc., statisticien, Institut national de santé publique du Québec
Christiane Sylvestre, M.A, psychopédagogue et autrice, Regroupement des Associations PANDA du Québec