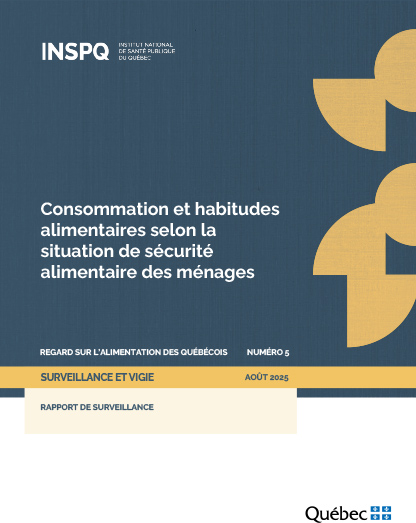Consommation et habitudes alimentaires selon la situation de sécurité alimentaire des ménages
Faits saillants
À partir des données sur la nutrition de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2015, cette étude documente la consommation et les habitudes alimentaires de la population québécoise selon la situation de sécurité alimentaire des ménages. L’insécurité alimentaire des ménages correspond à une situation où l’accès aux aliments est inadéquat ou incertain à cause de ressources financières insuffisantes. Les résultats montrent un portrait moins favorable chez les personnes vivant dans des ménages en insécurité alimentaire modérée ou grave, par rapport à celles vivant dans des ménages en meilleure sécurité alimentaire.
Dans les ménages en insécurité alimentaire modérée ou grave :
Consommation alimentaire selon le Guide alimentaire canadien (GAC) de 2007
- Les jeunes de 1 à 18 ans consommaient moins de portions de lait et substituts, notamment chez les garçons avec l’équivalent d’une portion en moins.
- Les femmes de 19 ans et plus consommaient près de deux portions de légumes et fruits en moins, en excluant les jus de fruits 100 % purs.
Consommation des « Autres aliments » exclus du GAC et des boissons
- Les « Autres aliments » contribuaient plus aux apports quotidiens en énergie chez les jeunes, soit une calorie sur quatre par rapport à une calorie sur sept.
- La consommation de boissons sucrées était plus souvent rapportée chez l’ensemble des groupes d’âge (61 % c. 38 %) et de façon plus marquée chez les jeunes (71 % c. 38 %).
- Trois fois plus de jeunes rapportaient avoir consommé des boissons gazeuses sucrées (33 %E c. 9 %) et des boissons aux fruits sucrées (30 %E c. 11 %).
Habitudes alimentaires lors des repas et des collations
- Les adultes prenaient moins souvent trois repas par jour (56 % c. 84 %) et les collations contribuaient plus à leurs apports en énergie (29 % kcal/jour c. 19 % kcal/jour).
Apports en énergie et en nutriments
- Chez les garçons, les protéines contribuaient moins aux apports énergétiques quotidiens, et les apports en thiamine, riboflavine, vitamine D et calcium étaient de 15 à 25 % plus faibles.
- Chez les femmes, les apports en énergie, glucides, lipides et fibres, ainsi qu’en plusieurs vitamines et minéraux étaient de 15 à 30 % plus faibles.
Ces résultats révèlent que l’insécurité alimentaire modérée ou grave dans les ménages du Québec en 2015 était associée à une plus faible consommation d’aliments sains au détriment d’une consommation plus élevée des « Autres aliments » et des boissons sucrées, surtout chez les jeunes de 1 à 18 ans, et à une prise moins fréquente de trois repas par jour chez les adultes. Ces constats pourront servir à mieux orienter les interventions auprès des individus les plus vulnérables afin de réduire les inégalités sociales en alimentation au Québec.