Rendez-vous recherche et innovation en santé publique
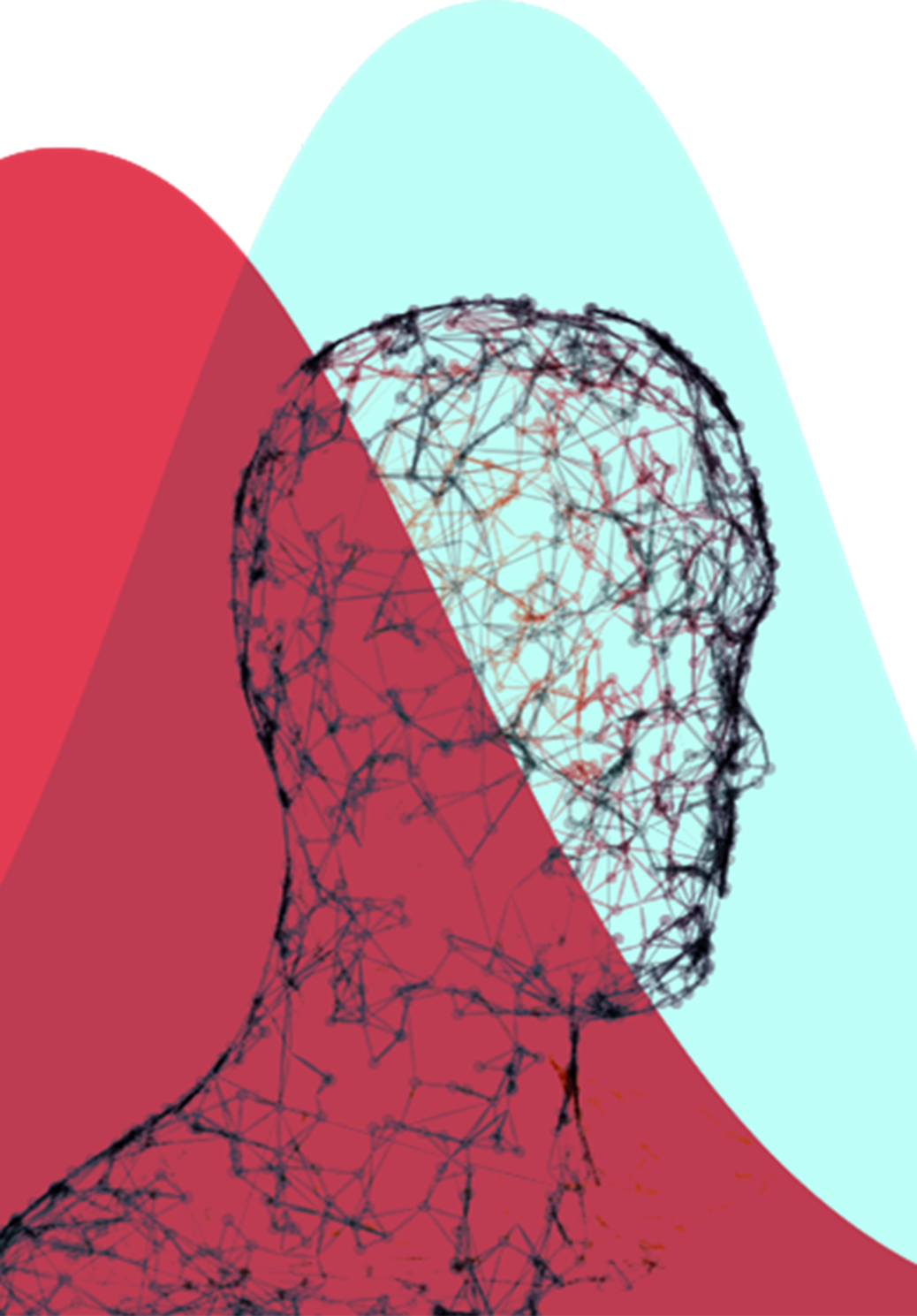
La première édition du Rendez-vous recherche et innovation en santé publique est née de la volonté de renforcer la synergie entre les milieux de la recherche et de la pratique en santé publique. La transformation de la société s’est accélérée sous l’effet de plusieurs grandes tendances, entraînant de nouveaux défis et des opportunités pour la santé publique. De nouvelles données, connaissances, méthodes, approches ou outils ont aidé à faire face aux enjeux actuels et futurs. Plus que jamais, des partenaires de divers horizons doivent collaborer à leur développement.
Cet événement a été présenté par l’Institut national de santé publique du Québec et ses partenaires universitaires. Nous remercions tout particulièrement l’École de santé publique de l’Université de Montréal et le Centre de recherche en santé publique, qui en ont été les hôtes, ainsi que l’Institut de la santé publique et des populations, grâce à qui la première partie a été accessible en ligne.
Par le biais de courtes présentations vulgarisées, les conférencières et conférenciers ont partagé des idées novatrices et inspirantes pour susciter une réflexion sur nos approches et pratiques en santé publique. En seconde partie d’événement, les participantes et participants sur place ont poursuivi les échanges avec les conférencières et conférenciers.
En espérant que ce premier rendez-vous a été pour vous une source d’inspiration et, qui sait, qu’il a pavé la voie à de nouvelles collaborations!
Le comité d'orientation
Consultez l'ensemble des présentations PPT et sur chaque lien ci-dessous, la vidéo des présentations.
Mot de bienvenue
Eric Litvak, vice-président aux affaires scientifiques de l’Institut national de santé publique du Québec et animateur de la journée souhaite la bienvenue aux participantes et participants. Il remercie les hôtes de la journée soient l’École de santé publique de l’Université de Montréal et le Centre de recherche en santé publique ainsi que l’Institut de la santé publique et des populations qui a rendu possible la webdiffusion et la traduction simultanée.
Carl Ardy-Dubois (doyen) et Michèle Bouchard (vice-doyenne à la recherche) de l’École de santé publique de l’Université de Montréal, Louise Potvin (directrice scientifique) du Centre de recherche en santé publique et Katherine Frohlich (directrice scientifique) de l’Institut de la santé publique et des populations prennent aussi la parole.
S'inspirer! Série de huit présentations
Approches communautaires en matière de santé publique : parlons de pouvoir plutôt que de forces
Depuis des décennies, l'action auprès des communautés les plus marginalisées et défavorisées est au cœur des politiques visant à atteindre une plus grande équité sociale et sanitaire à l'échelle mondiale, nationale et locale. Pourtant, les données probantes s'accumulent pour montrer que les approches communautaires en matière de santé publique n'ont qu'un succès limité et que certaines d'entre elles peuvent même nuire. Pourquoi en est-il ainsi? L’évaluation du programme anglais Big Local Community Empowerment souligne la nécessité de ne plus seulement se concentrer sur l’utilisation des forces et ressources locales pour changer les modes de vie et comportements, mais plutôt de renforcer le pouvoir de la communauté. Développer et soutenir ce pouvoir est essentiel pour s’attaquer aux facteurs structurels des inégalités sociales et sanitaires.
Jennie Popay est professeure émérite de sociologie et de santé publique à l'Université de Lancaster au Royaume-Uni. Elle est membre de l'académie des sciences sociales du Royaume-Uni, membre avec distinction de la faculté de santé publique du Royaume-Uni et a reçu la médaille pour services distingués de la British Sociology Association en 2022. Elle est coresponsable d'un important programme de recherche sur les inégalités de santé au sein de l'école anglaise de recherche en santé publique. Ses recherches portent notamment sur les déterminants sociaux de l'équité en matière de santé et l'évaluation des interventions et politiques basées sur la communauté.
Politiques, impacts et données probantes : un cycle vertueux
Les politiques de santé publique devraient s’appuyer sur les résultats de la recherche, mais un décalage persiste souvent entre ces deux domaines. Les méthodes d’évaluation d’impacts peuvent être appliquées de façon rétrospective pour en apprendre plus sur les impacts des politiques de santé publique ou de façon prospective pour évaluer de nouvelles réformes. Un cycle plus vertueux entre politiques, impacts et données probantes pourrait être créé en établissant des partenariats efficaces entre les chercheurs, les décideurs et le public.
Arijit Nandi est professeur agrégé à l'Université McGill au département d'équité, d'éthique et de politique et au département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail. Ses recherches portent sur les déterminants macroéconomiques de la santé des populations dans un contexte mondial. Il s'intéresse principalement à l'utilisation de modèles expérimentaux et quasi-expérimentaux pour évaluer l'impact des politiques et des programmes sur la santé et les inégalités en matière de santé. Il est membre fondateur de l'Observatoire des politiques publiques et de la santé des populations de McGill (3PO).
Améliorer la prévention des maladies transmises par les tiques avec l'approche « Une seule santé »
Les changements climatiques et les autres perturbations environnementales créent des conditions favorables à l’émergence des zoonoses au Canada, dont les maladies transmises par les tiques. Faire face à cet enjeu est complexe, car il concerne à la fois la santé des populations humaines et animales et la conservation des écosystèmes naturels. Cette présentation aborde la nécessité d'adopter des approches novatrices et intégrées qui appliquent l’approche « Une seule santé » afin de lutter contre ces problématiques.
Cécile Aenishaenslin est professeure à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et chercheuse au Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique et au Centre de recherche en santé publique. Son programme de recherche porte sur le développement et l’évaluation d’interventions qui appliquent une approche « Une seule santé » pour la prévention et le contrôle des maladies zoonotiques. Elle dirige le projet PARCS en Santé qui s’intéresse à la prévention des maladies transmises par les tiques dans le contexte des changements climatiques et anthropiques.
Quand les arts révèlent la santé publique
Cette présentation explore le potentiel des méthodes de recherche basées sur les arts pour enrichir la recherche en santé publique en donnant une voix puissante aux communautés. En impliquant directement les participants, ces approches artistiques permettent de saisir des expériences de santé souvent invisibles ou taboues, de faciliter le dialogue et d’offrir des perspectives uniques sur des enjeux complexes tels que les inégalités, le bien-être mental et les déterminants sociaux de la santé.
Olivier Ferlatte est professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche en santé publique. Il réinvente la recherche en santé publique avec une touche artistique. Collaborant avec les communautés 2S/LGBTQIA+, il bouscule les conventions en mobilisant des approches inspirées des arts pour transformer le savoir. Convaincu que la recherche doit être inclusive et accessible, il s’engage à faire de la recherche un outil de transformation sociale.
Utiliser les études mixtes pour orienter les politiques publiques : l’exemple du cannabis
Les études mixtes et interdisciplinaires sont essentielles pour comprendre les impacts des changements de la législation sur le cannabis. Elles incluent la combinaison de méthodes quantitatives (comme des enquêtes et des analyses statistiques) et qualitatives (telles que des entretiens ou des groupes de discussion) pour explorer les perceptions, les pratiques et les impacts de ces politiques sur les populations. La participation des experts en santé permet d’assurer une analyse plus approfondie des effets sur la santé publique et de proposer des recommandations éclairées pour l’élaboration et l’amélioration des politiques publiques.
José Ignacio Nazif-Muñoz est professeur agrégé aux programmes d’études et de recherche en toxicomanie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Il a obtenu un baccalauréat en sociologie (1999) à la Universidad de Chile et un doctorat en sociologie (2016) à l’Université McGill. Il a effectué une formation postdoctorale au Institute of Health and Policy de l’Université McGill (2017) et à la T.H. Chan School of Public Health de l’Université Harvard (2019). Ses principaux intérêts de recherche portent sur la compréhension de l’interaction entre la diffusion, la conception et la mise en œuvre des politiques publiques (y compris la réglementation de la consommation d’alcool et de cannabis) sur les populations vulnérables.
Interventions prometteuses en matière de violence dans les relations intimes chez les adolescentes et adolescents
Cette présentation aborde un enjeu mondial de santé publique qui préoccupe le Québec : la violence dans les relations intimes chez les adolescentes et adolescents. Un nombre croissant de recherches démontre que les adolescentes et adolescents vivant dans des contextes de vulnérabilité (ex. : racisme, pauvreté, marginalisation, etc.) sont plus susceptibles de subir et d’utiliser la violence dans leurs relations. En nous appuyant sur des recherches sur la violence conjugale menées à Montréal-Nord et sur les leçons de la collaboration intersectorielle entre différents actrices et acteurs, nous discutons d'approches territoriales et culturellement sensibles qui sont moins développées à ce jour et qui s'avèrent prometteuses quant à leur impact sur les déterminants sociaux de la santé et sur les facteurs structurels et environnementaux de ce problème.
Tatiana Sanhueza Morales est chercheuse en résidence au Centre de recherche et partage des savoirs InterActions, professeure associée à l’École nationale d’administration publique et professeure adjointe à l’Université de Concepción au Chili. Ses recherches portent sur la violence dans les relations intimes, notamment les expériences vécues par les adolescentes et adolescents qui peuvent les affecter dans leur parcours relationnel et leurs enjeux identitaires (genre, classe, génération, migration, etc.). Elle s’intéresse aux réponses sociales à cette problématique en mettant l’accent sur l’amélioration des réponses communautaires grâce à des efforts de collaboration intersectorielle.
Penser autrement notre lutte contre les pathogènes opportunistes multirésistants aux antibiotiques en milieu hospitalier
La lutte contre les infections nosocomiales est un enjeu majeur de santé publique. Ce problème est associé à l'environnement des éviers comme réservoir de pathogènes opportunistes en milieu hospitalier. Lors de la caractérisation écologique des pathogènes opportunistes dans des unités de soins intensifs, nous avons identifié quelques éviers exceptionnellement dépourvus de pathogènes, mais plutôt colonisés par une population microbienne antagoniste. Ceci suggère une nouvelle stratégie de contrôle qui réduirait les risques d’infections.
Eric Déziel est professeur-chercheur en microbiologie et biotechnologie au Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie de l’Institut national de la recherche scientifique. Formé en microbiologie environnementale et en pathogenèse microbienne, il s’intéresse aux micro-organismes dans leur milieu naturel et aux moyens qu’ils déploient pour survivre et causer des infections. Ses recherches se concentrent sur les pathogènes opportunistes et visent une meilleure compréhension de leurs comportements sociaux, telle la communication intercellulaire. Il recherche également des alternatives aux antibiotiques.
Médecine culinaire : une démarche pédagogique pour prendre soin autrement
La médecine culinaire est une approche novatrice qui associe les évidences médicales et nutritionnelles à l’art culinaire comme outil d’intervention, rendant les apprentissages pratiques et engageants. Elle dépasse la transmission de savoirs en les activant, transformant des connaissances latentes en actions concrètes et opérationnelles. En comblant le fossé entre théorie et pratique, cette discipline renforce la capacité d’agir et favorise l’autonomisation alimentaire ainsi que les saines habitudes culinaires, essentielles pour rétablir et maintenir la santé et le bien-être.
Michel Lucas est docteur en épidémiologie nutritionnelle, chef cuisinier diplômé et expert reconnu à l’international en nutrition et médecine culinaire. Professeur titulaire au Département de médecine sociale et préventive de l’Université Laval et chercheur au CHU de Québec, il bénéficie d’un parcours exceptionnel de 30 ans et d’une perspective unique : baccalauréat en nutrition, maîtrise en santé communautaire, doctorat en épidémiologie (Université Laval), postdoctorat en épidémiologie nutritionnelle avec Dr. Walter Willet (Harvard T.H. Chan School of Public Health) et diplôme de chef cuisinier (École hôtelière de la Capitale).
Mot de clôture
Eric Litvak, vice-président aux affaires scientifiques de l’Institut national de santé publique du Québec et animateur de la journée remercient les participantes et les participants de leur présence.
Comité d’orientation
Le comité détermine les grandes orientations et la programmation de l’événement.
- Eric Litvak, Institut national de santé publique du Québec
- Michèle Bouchard, École de santé publique de l’Université de Montréal
- Louise Potvin, Centre de recherche en santé publique
- Bahar Kasaai, Institut de la santé publique et des populations
- Maude Laberge, Université Laval
- Mylaine Breton, Université de Sherbrooke
- Gilles Paradis, Université McGill
- Marianne Mathis, Institut national de la recherche scientifique
- Nassera Touati, École nationale d’administration publique
- Carole Clavier, Réseau de recherche en santé des populations du Québec
- Cathy Vaillancourt, Regroupement intersectoriel de recherche en santé de l’Université du Québec et CommunAutés Rurales et Éloignées en Santé
Comité organisateur
Le comité veille à l’organisation et au bon déroulement de l’événement.
- Martine Isabelle, Institut national de santé publique du Québec
- Chantal Huot, École de santé publique de l’Université de Montréal
- Mireille Simard, Institut national de santé publique du Québec
Nous remercions également Ali Ben Charif, Marion Viau et Jane Ferland.
Cet événement a été présenté par l’Institut national de santé publique du Québec et ses partenaires universitaires. Nous remercions particulièrement l’École de santé publique de l’Université de Montréal et le Centre de recherche en santé publique qui ont été les hôtes de l’événement, de même que l’Institut de la santé publique et des populations grâce à qui la première partie a été rendue accessible en ligne.











