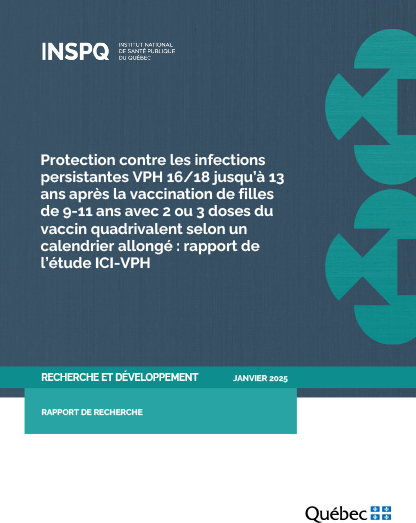Protection contre les infections persistantes VPH 16/18 jusqu’à 13 ans après la vaccination de filles de 9-11 ans avec 2 ou 3 doses du vaccin quadrivalent selon un calendrier allongé : rapport de l’étude ICI-VPH
Faits saillants
- Les virus du papillome humain (VPH) sont responsables de l’infection transmissible sexuellement (ITS) la plus courante dans le monde. Il en existe plus de 200 génotypes, dont certains sont potentiellement oncogènes.
- Il existe trois vaccins contre les VPH homologués au Canada : le Gardasil®, le Gardasil-9® et le Cervarix®. Le programme québécois de vaccination contre les VPH a débuté en 2008, ciblant les jeunes filles, en 4e année du primaire.
- Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a initialement envisagé l’utilisation d’un calendrier de vaccination allongé avec l’administration de trois doses à 0, 6 et 60 mois du vaccin quadrivalent (VPH 6, 11, 16 et 18) homologué pour être utilisé selon un calendrier de trois doses administrées sur six mois. Cette recommandation a été révisée au printemps 2013 par le CIQ qui a recommandé de ne pas administrer la troisième dose initialement prévue en 3e secondaire et de comparer l’efficacité clinique du calendrier allongé à celle du calendrier donné (comportant seulement deux doses à 6 mois d’intervalle). L’étude ICI-VPH a donc été mise en place pour évaluer ces calendriers vaccinaux.
- L’objectif principal de cette étude était d’évaluer si un calendrier vaccinal de deux doses (administrées à 0 et 6 mois) du vaccin quadrivalent (VPH‑4) n’est pas inférieur à un calendrier de trois doses (administrées à 0, 6 et 60 mois) du même vaccin pour la prévention des infections persistantes par un VPH de génotype 16 ou un VPH de génotype 18, jusqu’à 10 ans après l’administration de la première dose.
- De 2013 à 2016, 3 356 filles âgées de 13 à 16 ans ayant reçu deux doses du VPH-4 en 4e année du primaire (5 ans auparavant) ont été réparties aléatoirement (1:1) afin de recevoir (n = 1 681) ou de ne pas recevoir (n = 1 675) une troisième dose de vaccin (dose de rappel 60 mois après la première dose) et incluses dans l’analyse.
- Les participantes recrutées résidaient dans les régions élargies de Montréal (50,5 %), de Québec (42,9 %) et du Saguenay–Lac-Saint-Jean (6,5 %).
- Les participantes ont effectué un autoprélèvement vaginal tous les 6 mois pour le test de détection des VPH et ont rempli chaque année un questionnaire sur leurs habitudes de vie et sexuelles.
- Les 500 premières participantes recrutées ont également contribué aux analyses d’immunogénicité en fournissant des prélèvements sanguins.
- Les premières participantes ont aussi été invitées à prolonger leur participation au‑delà de la période de suivi initiale de 5 ans, pour un suivi pouvant aller jusqu’à 8 ans (13 ans après l’administration de la première dose).
- Au moment du recrutement, 16 % des participantes ont rapporté avoir déjà eu un contact sexuel au cours de leur vie (âge moyen : 14,8 ans), alors que cette proportion est passée à 83 % (âge moyen : 20,2 ans) en analysant l’ensemble des questionnaires de suivi (participantes ayant répondu avoir eu des contacts sexuels à au moins un moment au cours du suivi).
- Près de 40 % des participantes (similaire dans les deux groupes à l’étude) ont obtenu au moins un résultat VPH positif (au moins un génotype) au cours du suivi.
- Parmi les 17 000 tests de génotypage effectués, très peu d’infections aux VPH vaccinaux (6/11/16/18) ont été détectées au recrutement et durant toute la période de suivi. Au total, 28 participantes ont eu une infection incidente de génotypes VPH 16 ou 18, dont une seule (ayant reçu une dose de rappel) était persistante (VPH 16), mais d’une durée limitée (prélèvements subséquents négatifs).
- Considérant le très faible nombre d’infections persistantes (ou possiblement persistantes) obtenues, soit une infection persistante et cinq prélèvements positifs au dernier prélèvement (trois du groupe 2 doses et deux du groupe 2 doses + dose rappel) ne permettant pas de statuer sur la persistance, les analyses statistiques prévues pour l’objectif principal n’ont pas pu être réalisées (ex. analyse de survie).
- Les résultats parmi les participantes ayant également fourni des prélèvements sanguins indiquent une persistance des anticorps 10 ans après l’administration de deux doses du vaccin VPH-4.
- Une dose de rappel est très immunogène lorsqu’administrée plusieurs années (5 ans) après la primo-vaccination avec 2 doses de vaccins espacées de 6 mois. Cette dose a entraîné de fortes augmentations des titres d’anticorps vaccinaux, indiquant la présence d’une mémoire immunitaire.
- Comparativement au groupe 2-dose (sans dose de rappel), les titres d’anticorps aux génotypes du vaccin VPH-4 étaient plus élevés après l’administration d’une dose de rappel, mais la différence était moins prononcée 5 ans après la dose de rappel que 2,5 ans après celle-ci.
- Le très faible nombre d’infections persistantes associées aux génotypes vaccinaux, et ce, dans les deux groupes à l’étude (une seule confirmée), illustre l’excellente protection clinique conférée par la vaccination contre les VPH, même lorsque les niveaux d’anticorps mesurés sont bas.
- Les résultats de la présente étude montrent qu’un calendrier vaccinal à deux doses du vaccin VPH-4 procure une protection quasi complète contre les infections persistantes par les VPH 16/18 jusqu’à 13 ans après la vaccination, suggérant qu’une troisième dose (dose de rappel) n’apporterait pas de bénéfice supplémentaire.
- Une étude réalisée au Québec, avant l’implantation du programme de vaccination, montrait des incidences des VPH 16 et 18, 22 à 65 fois plus élevées que celles estimées dans le cadre de la présente étude réalisée chez de jeunes filles vaccinées avec deux ou trois doses de VPH‑4. Grâce à la vaccination, de nombreuses infections incidentes et persistantes ont été évitées.
- Depuis la réalisation de cette étude, des données indiquent qu’une seule dose de vaccin contre les VPH procure une très bonne protection. La vaccination contre les VPH constitue une intervention préventive d’une efficacité exceptionnelle.