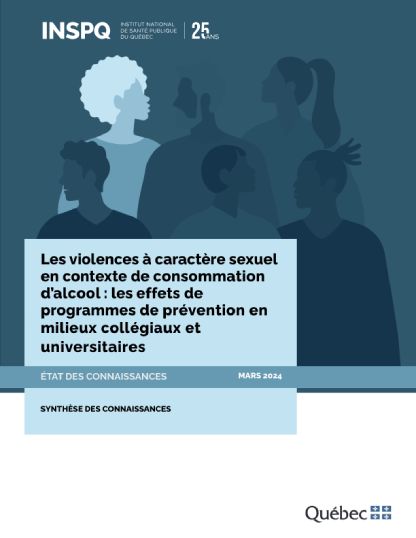Les violences à caractère sexuel en contexte de consommation d’alcool : les effets de programmes de prévention en milieux collégiaux et universitaires
Mise en contexte et objectifs
La problématique des violences à caractère sexuel (VACS) constitue un enjeu de santé publique préoccupant. Le terme VACS renvoie au continuum de formes, criminelles ou non, que ces violences peuvent prendre. Il peut s’agir d’attitudes, de gestes, de paroles ou de comportements à connotation sexuelle et non désirés. Les VACS, qui touchent particulièrement les jeunes adultes, peuvent être commises ou vécues dans un contexte de consommation d’alcool. D’ailleurs, l’alcool est la substance psychoactive la plus souvent présente dans les cas de VACS. Or, il n’existe pas de balises claires quant à la manière d’aborder conjointement les VACS et l’alcool dans une perspective de prévention.
Au Québec, la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur exige pour tous les milieux collégiaux et universitaires de se prémunir de politiques d’action pour lutter contre les VACS depuis 2019. Les personnes expertes en prévention des VACS sur les campus sont au fait des enjeux entourant les violences à caractère sexuel en contexte de consommation d’alcool (VACSA). Toutefois, elles soulignent aussi la difficulté d’aborder cette problématique sans recourir à des messages préventifs qui auraient pour effet de blâmer les personnes victimes ou d’excuser les personnes auteures en justifiant la violence commise par les effets de l’alcool.
La présente synthèse des connaissances a pour objectif de réaliser un état des connaissances sur les effets de programmes de prévention des VACS qui ont une composante portant sur l’alcool en milieux d’enseignement supérieur. Ce travail vise plus spécifiquement à : 1) identifier les programmes de prévention des VACS qui ont une composante portant sur l’alcool en milieux d’enseignement supérieur et qui ont fait l’objet d’une évaluation quant à leurs effets, et décrire leurs effets, ainsi qu’à 2) dégager des constats à l’égard des effets et de la mise en oeuvre des programmes en prévention des VACSA.
Méthodologie
Cette synthèse des connaissances adopte l’approche de la revue narrative systématisée des écrits scientifiques. Selon les critères d’admissibilité établis, treize études, dont l’objectif était d’évaluer les effets de dix programmes visant à prévenir les VACS et ayant une composante portant sur l’alcool, ont été recensées. Une grille d’extraction a permis de colliger les données de chaque étude. Résultats et constats L’ensemble des programmes évalués dans les études recensées avaient pour effet de diminuer, soit le risque d’être victime de VACS ou de perpétrer un comportement associé aux VACS, soit l’adoption d’attitudes et de comportements associés à la victimisation ou à la perpétration de VACSA. Quatre constats à l’égard des effets et de la mise en oeuvre des programmes en prévention des VACSA sont établis.
Résultats et constats
L’ensemble des programmes évalués dans les études recensées avaient pour effet de diminuer, soit le risque d’être victime de VACS ou de perpétrer un comportement associé aux VACS, soit l’adoption d’attitudes et de comportements associés à la victimisation ou à la perpétration de VACSA. Quatre constats à l’égard des effets et de la mise en oeuvre des programmes en prévention des VACSA sont établis.
Constat no1 : Les programmes combinant des thématiques liées à l’alcool et aux violences à caractère sexuel auraient davantage d’effets prometteurs quant à la prévention de la victimisation que ceux abordant uniquement l’une des deux thématiques.
Toutes les études évaluant les programmes documentés dans cette synthèse ont mesuré des effets sur la diminution des VACS ou d’attitudes et de comportements qui y sont associés. Trois d’entre elles, qui évaluent des programmes visant à prévenir la victimisation, suggèrent que de combiner des thématiques liées à l’alcool et à la sexualité serait plus prometteur que d’aborder uniquement l’une ou l’autre des thématiques. Deux de ces études ont d’ailleurs montré une plus grande diminution de la victimisation associée aux VACS en combinant les deux thématiques. Une diminution des attitudes, des comportements et des situations associés aux VACSA, comme les épisodes de trous noirs, a également été relevée.
Constat no2 : Les programmes qui s’adressent à des populations spécifiques auraient des effets sur des facteurs de perpétration ou de victimisation associés à leur réalité.
Parmi les treize études retenues dans cette synthèse, huit ont évalué des programmes s’adressant à des populations spécifiques au sein de la population étudiante. Trois programmes ciblaient une population s’identifiant au genre féminin, celle-ci étant considérée comme plus à risque d’être victime de VACS, et deux ciblaient uniquement une population s’identifiant au genre masculin, considérée comme plus susceptible d’en perpétrer. Un autre programme ciblait les étudiantes et étudiants athlètes, considérés comme plus susceptibles de soutenir des mythes banalisant les VACS et ayant généralement de l’influence sur le reste de la population étudiante. Parmi ces programmes, certains ciblaient plus particulièrement des étudiantes ou des étudiants ayant une consommation excessive d’alcool.
Les études évaluant les programmes ciblant des étudiantes ayant une consommation excessive d’alcool ont mesuré davantage d’effets chez celles ayant vécu des VACS dans le passé que chez celles n’en ayant pas vécu. En tenant compte de la victimisation antérieure, ces études suggèrent qu’il est prometteur d’adopter une approche individualisée et empathique pour intervenir à la fois sur la consommation d’alcool et sur les VACS, en mettant de l’avant la capacité d’action des participantes. Cette approche vise à susciter une réflexion personnelle sur leurs habitudes de consommation, afin d’agir sur des facteurs associés aux risques de VACS (p. ex. consommation excessive d’alcool, adhésion à des mythes concernant les VACSA, sentiment d’incertitude à l’égard de sa propre consommation et de ses effets).
Les études portant sur des programmes visant à prévenir la perpétration de VACS chez des étudiants mesurent une diminution des comportements de VACS et des attitudes qui les banalisent. Pour ce faire, les activités abordent principalement des thématiques visant à déconstruire les croyances et les mythes liés aux VACS et à l’alcool, ainsi qu’à éduquer aux enjeux concernant l’hypermasculinité et les rôles de genre. Elles visent aussi à développer des compétences communicationnelles en matière de sexualité et des habiletés pour intervenir lorsqu’ils sont témoins de VACS. De plus, elles ont pour but de sensibiliser à la consommation excessive d’alcool qui est favorisée par l’environnement étudiant et à ses effets sur les attitudes et les comportements liés à la sexualité, notamment sur le consentement. Quant à l’étude évaluant le programme ciblant les athlètes, les résultats suggèrent que cette population peut contribuer à modifier les normes sociales et à prévenir les VACSA.
Constat no3 : L’implication et la formation d’étudiantes et d’étudiants pairs sont des composantes facilitant la mise en oeuvre des programmes.
Les personnes ayant participé aux programmes mis en oeuvre par des pairs ont rapporté une grande satisfaction à cet égard. Par exemple, les études portant sur les programmes destinés à une population strictement masculine suggèrent qu’une intervention déployée par des pairs masculins adoptant une posture de non-jugement contribue à établir un lien de confiance avec les participants. Les pairs intervenants exerceraient ainsi une influence positive pour déconstruire les mythes liés aux VACSA, et pour offrir des alternatives à l’hypermasculinité en lien avec la sexualité et la consommation d’alcool. La littérature sur ce sujet suggère qu’impliquer des étudiantes et des étudiants pairs constitue une bonne pratique, et qu’il s’agit d’un facteur favorisant l’adhésion aux messages de prévention.
Constat no4 : La formation de témoins avertis et actifs aurait des effets prometteurs pour prévenir les violences à caractère sexuel en contexte de consommation d’alcool.
La moitié des programmes évalués par les études retenues vise notamment à former des témoins avertis et actifs en cas de situations de VACS, par exemple lors d’événements où il y a consommation d’alcool. Ces programmes visent à augmenter la volonté des participantes et des participants à intervenir lors de situations de VACS, et à favoriser leur confiance à le faire. Les activités sont dédiées à l’acquisition de connaissances pour savoir reconnaître les situations de VACS, et au développement d’habiletés requises pour agir de manière adéquate et efficace lors de ces situations. Étant donné la forte influence des pairs, miser sur la formation de témoins avertis et actifs constitue un moyen d’agir sur la transformation des normes banalisant les VACS. Plus précisément, comme plusieurs cas de VACS se produisent dans des contextes sociaux impliquant une consommation excessive d’alcool, il semble essentiel de développer des habiletés spécifiques à ces contextes.
Conclusion
Les études retenues dans cette synthèse suggèrent que les programmes visant à prévenir les VACS en milieux d’enseignement supérieur et ayant une composante portant sur l’alcool auraient des effets prometteurs pour prévenir les VACSA. Toutefois, le nombre limité d’études évaluant de tels programmes montre la nécessité de les documenter davantage et de mener plus d’études pour évaluer l’efficacité des initiatives de prévention des VACSA, afin d’identifier les meilleures approches et pratiques de prévention en ce sens.