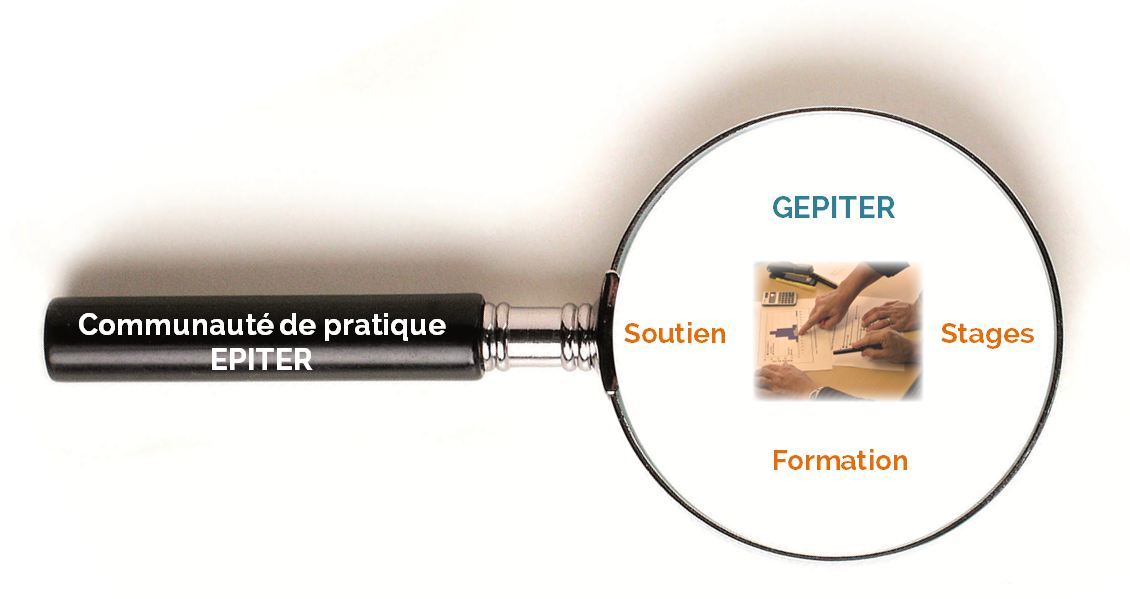Épidémiologie de terrain
Sur cette page
Depuis 2007, le groupe d’experts en épidémiologie de terrain (GEPITER) de l’INSPQ soutient le développement des compétences en la matière dans le réseau de la santé et des services sociaux. Pour ce faire, il mène un ensemble d‘activités auprès des professionnelles et professionnels du domaine de la protection de la santé.
L’épidémiologie de terrain est l’application d’un ensemble de concepts, de méthodes et d’outils pour évaluer des problèmes de santé imprévus. Ceux-ci exigent souvent une intervention rapide en raison de leur gravité, de leur ampleur ou de leur impact négatif sur la population touchée. On peut notamment penser à l’investigation d’une éclosion d’étiologie infectieuse ou d’un agrégat inhabituel de cas d’une maladie ou d’un problème qui peut présenter une menace pour la santé d’une population.
L’épidémiologiste de terrain se situe au centre de l’action et commence bien souvent son travail sans une hypothèse claire. Devant un problème de santé à caractère urgent, il doit recueillir des données suffisantes pour effectuer une intervention et informer rapidement les personnes clés afin d’assurer la protection de la santé des individus ou de la population à risque.
Groupe d’experts en épidémiologie de terrain (GEPITER)
Les membres de Gepiter sont permanents. Ils proviennent de l’INSPQ, du ministère de la Santé et des Services sociaux, de Santé Québec, de l’École de santé publique de l’Université de Montréal et de l'Agence de la santé publique du Canada.
Responsable
- Mireille Barakat, conseillère scientifique, Direction des risques biologiques, Institut national de santé publique du Québec.
Membres
- Louise Alain, conseillère scientifique, Direction de la santé environnementale, au travail et de la toxicologie, Institut national de santé publique du Québec.
- Juliana Ayres Hutter, conseillère scientifique, Direction des risques biologiques, Institut national de santé publique du Québec.
- Jacinthe Blouin, médecin-conseil, Direction de santé publique, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre
- Réjean Dion, médecin-conseil, Laboratoire de santé publique du Québec, Institut national de santé publique du Québec.
- Colette Gaulin, médecin-conseil, Bureau de surveillance et de vigie, ministère de la Santé et des Services sociaux.
- Kathleen Laberge, directrice du programme canadien d’épidémiologie de terrain, Agence de la santé publique du Canada.
- Claudie Laprise, professeur adjointe, Département de médecine sociale et préventive, École de santé publique de l’Université de Montréal.
- Esmé Lanktree, épidémiologiste principale, Direction générale de la réglementation, des opérations et de la gestion des urgences, Agence de la santé publique du Canada
- Éric Levac, médecin-conseil, Direction de santé publique, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre.
- Lauriane Padet, conseillère scientifique spécialisée, Direction des risques biologiques, Institut national de santé publique du Québec.
- Anne Perrocheau, médecin épidémiologiste, présidente de l’Association pour le développement de l’épidémiologie de terrain (Épiter).
- Noémie Savard, médecin-conseil, Direction des risques biologiques, Institut national de santé publique du Québec.
Formation
Selon les besoins exprimés par le réseau de la santé, l’INSPQ a élaboré plusieurs activités de développement de compétences en protection de la santé publique. Deux formations présentent les connaissances et l’expertise méthodologique nécessaires à l’accomplissement de cette fonction essentielle de santé publique :
- Formation en épidémiologie de terrain et protection de la santé (GEPITER+).
- Formation universitaire : Investigation d’éclosions
Stages
Les stages au sein du GEPITER permettent de renforcer les compétences et les habiletés acquises en épidémiologie de terrain. Les stagiaires peuvent ainsi participer à la surveillance de maladies infectieuses ainsi qu’à l’enseignement et à la formation de leurs pairs.
Communauté de pratique

L’INSPQ a créé une communauté de pratique en épidémiologie de terrain (CP-EPITER) en 2014 dans le cadre d’un projet soutenu par l'Agence de la santé publique du Canada. Cette initiative permet de faciliter la promotion des différentes activités du GEPITER : : le soutien, la formation et les stages.
Ce lieu virtuel, créé par et pour le personnel professionnel et formateur, permet aux apprenants et apprenantes francophones œuvrant ou intéressés à l'épidémiologie de terrain d’échanger. La communauté de pratique est hébergée sur une plateforme Web 2.0 du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique. Elle est accessible gratuitement au Canada et à l’international. Son contenu est enrichi par les membres qui partagent sur une base volontaire des expériences, des méthodes, des outils de travail, des activités et des ressources de formation continue.
La communauté compte près de 650 membres et plusieurs groupes de discussion sur diverses thématiques en lien avec l’épidémiologie de terrain.
Pour plus d'informations sur la CP-EPITER ou pour vous inscrire, écrivez-nous à [email protected].
Consultez le programme des conférences 2025-2026