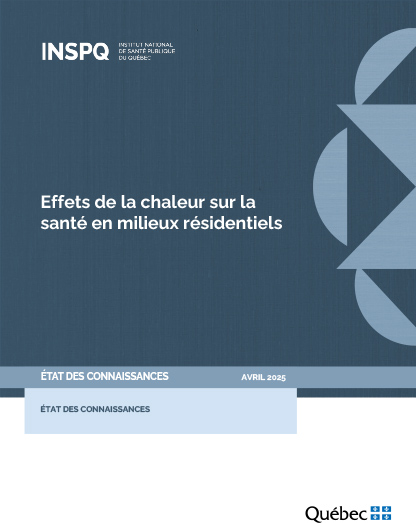Effets de la chaleur sur la santé en milieux résidentiels
Messages clés
- La population passe près de 90 % de son temps en milieux intérieurs où la température peut fluctuer de façon différente de la température extérieure. La vulnérabilité des occupants et occupantes à la chaleur est également associée à différents déterminants physiologiques, sociaux ou environnementaux. De même, les caractéristiques structurales et mécaniques de ces milieux, dont les logements, peuvent contribuer à définir leur potentiel de surchauffe en période de chaleur.
- L’objectif de ce document est de rapporter les principaux éléments issus d’une synthèse des connaissances sur la température intérieure (en contexte résidentiel) au-delà de laquelle des effets physiologiques, cognitifs ou une perte de confort peuvent être observés chez les adultes.
- Cette synthèse a permis d’identifier certaines des conditions intérieures susceptibles de stimuler l’activation des mécanismes physiologiques de thermorégulation chez les individus exposés à la chaleur. Les premiers effets physiologiques, comme l’augmentation du rythme cardiaque, pourraient se manifester à partir de 26 °C selon certaines études. Dans un contexte où la température augmenterait davantage, d’autres effets pourraient être rapportés, tels qu’une baisse de la tension artérielle diastolique et une élévation de la température tympanique, à partir de 30 °C. Il est à noter toutefois que ces effets physiologiques se manifestent en lien avec des changements de température par rapport à des températures de référence qui diffèrent d’une étude à l’autre.
- D’autres effets complémentaires d’intérêt ont également été documentés par les autrices et auteurs consultés lorsque les températures, l’humidité relative et la durée d’exposition augmentent (p. ex. effets cognitifs indésirables, dégradation de la qualité du sommeil, augmentation de la température cutanée, tympanique et corporelle, diminution du confort).
- Les résultats de la présente analyse suggèrent qu’à partir de 26 °C, plus la température intérieure augmente, plus la probabilité d’observer des effets physiologiques augmente. Alors que les conséquences sanitaires consécutives à la manifestation des effets physiologiques s’avèrent difficilement quantifiables à l’heure actuelle, ces premières seraient vraisemblablement tributaires de l’influence de certains facteurs environnementaux auxquels s’ajoutent des facteurs de vulnérabilité ou de protection individuels.
- Les valeurs médianes des plages de confort thermique relevées dans les études sélectionnées se situent principalement entre 26 °C et 27,6 °C pour une humidité relative comprise entre 50 % et 60 %.
- Plusieurs des études ont été menées en Asie, sur de jeunes adultes en bonne santé, sur de courtes durées et n’ont pas considéré de façon systématique certaines problématiques de santé (p. ex. problèmes rénaux, santé mentale, etc.), ce qui limite la transposabilité des résultats au Québec.